LGV.BT.free.fr
Dernière mise à jour le 14 aout 2016
Les premiers pas vers la
ligne à grande vitesse de BORDEAUX à TOULOUSE
Le présent article est extrait du livre :
Les liaisons ferroviaires entre Bordeaux
et Toulouse
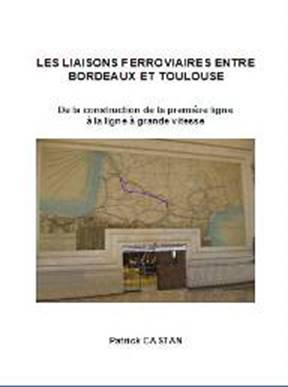
Les
premières lignes à grande vitesse
La SNCF ouvre la voie de la grande vitesse en
établissant le record du monde sur une ligne de l’ancien réseau de la Compagnie
du Midi :
Le premier projet de ligne à grande vitesse
émerge au sein de la SNCF dix ans plus tard pour une liaison de Paris vers le
Nord. Finalement, c’est la ligne de Paris à Lyon qui sera la première
réalisation : approuvée en 1971, et mise en service en 1981. Le projet
répondait à un double objectif, augmenter la capacité de la ligne existante, et
améliorer le service offert aux voyageurs entre Paris et Lyon. Ce fut un franc
succès qui ouvrait la voie à une deuxième réalisation française :
Des schémas
directeurs pour un réseau de lignes à grande vitesse
L’idée de créer un réseau de lignes à grande vitesse
avait germé dès les premiers succès du TGV, tant au niveau français qu’au
niveau européen. Le sigle TGV (Train à Grande Vitesse) désignait à l’origine le
système grande vitesse englobant infrastructure et trains. Ainsi, en 1985, les
compagnies de chemins de fer et les instances européennes joignent leurs
efforts pour engager une réflexion commune qui conduira à publier, le 30 juin
1986, le rapport de la commission européenne « Vers un réseau européen de
trains à grande vitesse ». Dans ce dossier, la liaison de Bordeaux à
Toulouse et Marseille figure comme élément d’interconnexion entre les liaisons
de Paris à Bordeaux et Madrid d’une part, et de Paris à Marseille d’autre part,
sans être classée prioritaire à l’horizon 2020 comme celles-là. Finalement ce
rapport donnera lieu à l’adoption par le Conseil des ministres européens, en
décembre 1990, d’un schéma directeur des TGV européens. Et cette vision
européenne se maintiendra au fil du temps en mettant l’accent sur les sections
internationales, comme Dax-Madrid identifiée comme prioritaire dans la décision
européenne du 23 juillet 1996.
La comparaison de la carte ferroviaire telle
qu’elle ressort de la loi de 1842 avec celle du rapport de la commission de
1986 pour ce qui concerne la partie française, fait apparaître une seule
différence notable. Elle concerne la relation ferroviaire entre Bordeaux,
Toulouse et Marseille. En effet celle-ci était une priorité lors de la
construction du réseau français mais a été omise par les concepteurs du réseau
européen et l’on peut regretter cette omission de la part des experts et des
rapporteurs. Le schéma directeur français corrigera cet écart comme nous allons
le voir.
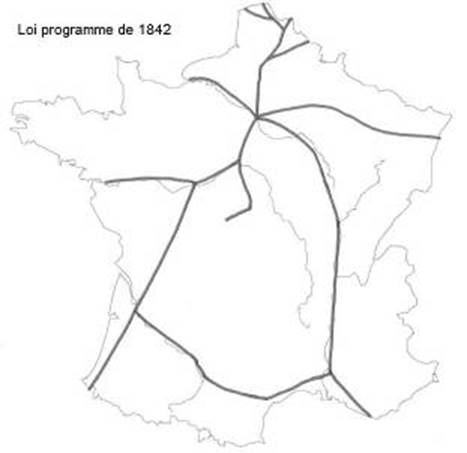

Carte des
priorités ferroviaires de la loi de 1842 Vision
européenne du réseau ferroviaire grande vitesse en 1986
En effet, en parallèle de la démarche
européenne, la France a élaboré un schéma directeur des liaisons ferroviaires à
grande vitesse. Mis à l’étude en 1989, il sera adopté par le comité
interministériel d’aménagement du territoire du 14 mai 1991 et publié par un
décret en date du 1er avril 1992. Il s’agissait du premier schéma
directeur étudié en vertu des dispositions de la loi d’orientation des
transports intérieurs du 30 décembre 1982. Des schémas directeurs
d’infrastructures devaient ainsi être établis par l’Etat pour assurer la
cohérence à long terme des réseaux pour les différents modes de transports et
pour définir les priorités en matière de modernisation, d’adaptation et d’extension
des réseaux.
L’élaboration du schéma directeur des liaisons
ferroviaires à grande vitesse a fait l’objet d’une procédure de consultation
menée dans une période d’euphorie. Il comprend seize projets nouveaux,
représentant
Le rapport de M. Rouvillois
en 1996 sur les modalités de mise en œuvre du schéma directeur de 1991 confirme
que ce schéma s’est révélé irréaliste du fait de la conjugaison de
l’augmentation du coût de construction et de la surestimation des recettes
attendues. Les hypothèses financières se fondaient sur un coût kilométrique de
construction pouvant varier entre 4,6 et 10,7 millions d’euros selon la
complexité des ouvrages spéciaux à réaliser. Aux conditions économiques de
1994, le coût de la ligne à grande vitesse Atlantique est de 5,2 millions
d’euros au kilomètre ; 6,1 pour la ligne à grande vitesse Nord ; 8,4
pour la ligne à grande vitesse Rhône Alpes ; 14 pour la ligne à grande
vitesse Méditerranée. Le renforcement des obligations réglementaires et les
exigences croissantes pour l’insertion des lignes nouvelles expliquent la
progression des coûts qui touche, dans la même période, l’ensemble des
infrastructures de transport en Europe. Il en résulte que pour les autres
lignes du schéma directeur, une fois les estimations révisées, aucun des projets
n’a de rentabilité suffisante pour pouvoir être financé sans une contribution
importante des collectivités publiques.
Le débat public
pour la ligne à grande vitesse de Bordeaux à Toulouse
Si des réalisations partielles du schéma
directeur de 1991 avaient eu lieu, rien n’avait bougé pour la liaison de
Bordeaux à Toulouse à l’époque du rapport de 1996, et il faut attendre décembre
2002, pour que le Comité interministériel d’aménagement et de développement du
territoire prévoit la réalisation des études concernant la liaison ferroviaire
de Bordeaux à Toulouse et Narbonne afin qu’un débat public puisse avoir lieu.
La même année 2002, Réseau ferré de France
avait engagé la réalisation d’une étude d’amélioration des services
ferroviaires sur l’axe de Bordeaux à Toulouse et Narbonne, ceci dans le cadre
des contrats de plan Etat-Région des trois régions concernées. En conclusion de
cette étude, la réalisation d’une ligne à grande vitesse entre Bordeaux et
Toulouse fut jugée pertinente comme première étape de l’aménagement complet de
l’axe. Anticipant les conclusions de l’étude, le Comité interministériel
d’aménagement et de développement du territoire du 18 décembre 2003 inscrit la
ligne à grande vitesse de Bordeaux à Toulouse sur la carte des infrastructures à long terme, en annonçant un débat public en
2005.

Les
principaux projets ferroviaires en 2003
Les études sont ensuite réalisées par Réseau
ferré de France en 2004 pour approfondir les aspects fonctionnels,
socio-économiques, techniques, environnementaux et relatifs à l’aménagement du
territoire à un niveau suffisant pour permettre au public le plus large
possible de débattre du projet en connaissance de cause. Confié à la Commission
nationale du débat public, le débat s’est déroulé sur la base de ces études,
entre juin et novembre 2005.
Les grandes attentes vis-à-vis du projet telles
qu’elles ressortent du dossier du maître d’ouvrage, dont on ne peut que
recommander la lecture, sont au nombre de cinq :
- Assurer une part croissante des déplacements
de voyageurs sur la liaison ferroviaire radiale de Toulouse à Bordeaux et
Paris.
- Participer au développement de l’axe
transversal de l’Atlantique à la Méditerranée.
- Favoriser une desserte équilibrée des
territoires traversés.
- Permettre le développement des transports
ferroviaires régionaux de voyageurs.
- Accroître les possibilités de développement
du transport ferroviaire de marchandises.
Deux grands projets ferroviaires structurants
étaient pris en considération pour la conduite des études : la ligne à
grande vitesse de Tours à Bordeaux, et la suppression du bouchon ferroviaire de
Bordeaux permettant de dégager de la capacité au nord de
L’objet du débat public est d’orienter les
choix fonctionnels de la ligne à construire en comparant des scénarios de
desserte. Le premier choix fonctionnel consiste à relier les deux capitales
régionales en une heure, avec une ligne nouvelle d’environ
Le débat public a permis d’éliminer deux
scénarios du fait de la préférence marquée des acteurs locaux pour une gare
nouvelle à Montauban. Sa localisation au sud de la ville s’intègre
harmonieusement dans la dynamique d’extension de
La gare nouvelle d’Agen n’a pas pu réunir le
même consensus à l’époque du débat public de sorte que la question reste
ouverte au début des études de tracé engagées pour la préparation de l’enquête
d’utilité publique et une décision devra être arrêtée dès le début de ces
études pour ne pas multiplier les coûts, ni compromettre les délais. Notons
toutefois que la solution consistant à n’utiliser que la gare existante pour
toutes les dessertes ferroviaires, n’est pas à recommander du point de vue
strictement ferroviaire, tant pour les coûts de construction que pour les
possibilités d’évolution de la desserte d’Agen sur la durée de vie de
l’infrastructure nouvelle.
Le bilan socio-économique du projet confirme
son intérêt, avec une très faible différence entre les quatre scénarios de
desserte soumis au débat. Compte tenu du niveau de précision de ces études, le
choix d’un scénario ne s’impose pas du fait de l’étude économique, mais il
relève d’une logique d’insertion dans l’environnement et le cadre de vie, et
des politiques d’aménagement du territoire.
Pour le tracé de la ligne, trois options de
passage sous forme de bandes de dix kilomètres de large ont été soumises au
débat. Notons toutefois que la plus grande partie du tracé, du nord de Toulouse
jusqu’au sud de Port-Sainte-Marie comporte une seule option de passage. Par
contre pour le reste du parcours, les tracés sont, pour l’un au nord de la
Garonne, pour l’autre à proximité de l’autoroute longeant la Garonne par le
sud, et le troisième encore plus au sud en passant à hauteur de Captieux. Cette
dernière option est la plus économique compte tenu des moindres difficultés de
réalisation que l’on peut rencontrer sur le parcours et elle est adaptée à la
réalisation d’un tronc commun pour un prolongement vers l’Espagne. Le débat
public de la ligne à grande vitesse de Bordeaux à Toulouse n’a pas permis
d’éliminer l’une ou l’autre de ces options.
A l’issue du débat public et après la remise du
rapport de la Commission du débat public, le Conseil d’Administration de Réseau
ferré de France a décidé le 13 avril 2006, de poursuivre les études avec comme
prochain objectif, la réalisation d’une enquête d’utilité publique.

Les
options de passage pour
Le tronc commun de
Bordeaux vers Toulouse et l’Espagne
Un autre débat public, celui relatif aux
liaisons ferroviaires entre Bordeaux et l’Espagne s’est tenu entre août et
décembre 2006, en application de la décision du Comité interministériel du
développement et de l’aménagement du territoire de 2003. Le débat était plus
complexe car englobant des problématiques fret et voyageurs.
A l’issue du débat public et après la remise du
rapport de la Commission du débat public, le Conseil d’Administration de Réseau
ferré de France a décidé, le 8 mars 2007, de poursuivre les études avec comme
prochain objectif, la réalisation d’une enquête d’utilité publique, en prenant
en compte un tracé de ligne nouvelle par l’est des Landes permettant de
réaliser un tronc commun avec la ligne à grande vitesse de Bordeaux à Toulouse.
Le projet de ligne nouvelle de Bordeaux à
Hendaye se place dans un programme global d’amélioration des liaisons
ferroviaires de l’axe, comprenant des études d’amélioration des performances de
la ligne existante, des études d’amélioration de la desserte du bassin
d’Arcachon, et les études de mise en cohérence des projets français et espagnol
de part et d’autre de la frontière.
Pour ce qui concerne la ligne nouvelle
proprement dite, les caractéristiques fonctionnelles du projet sont plus
complexes que celui de la ligne à grande vitesse de Bordeaux à Toulouse, du
fait qu’elle doit être conçue pour recevoir des trains de fret dont les
exigences de performance sont sensiblement différentes de celles requises pour
des trains à grande vitesse. Plus précisément, entre Bordeaux et Dax, la ligne
doit permettre des circulations de trains voyageurs à
Le tronc commun avec la ligne à grande vitesse
de Bordeaux à Toulouse conduit à exporter les contraintes de la mixité des
circulations sur le projet Bordeaux-Toulouse, mais permet aussi d’envisager un
raccordement entre la branche vers Bayonne et celle vers Toulouse, au niveau de
son extrémité sud pour assurer des liaisons directes entre ces deux villes sans
passer par Bordeaux.

Superposition
des options de passage Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Espagne
La liaison
ferroviaire de Bordeaux à Toulouse et Narbonne
Une étude d’amélioration des services
ferroviaires sur l’axe de Bordeaux à Toulouse et Narbonne a été menée par
Réseau ferré de France dans le cadre des contrats de plan Etat-Région de
l’Aquitaine, Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon en 2002 et 2003.
Les objectifs d’amélioration visaient à
répondre aux attentes, d’une part des voyageurs longue distance et moyenne
distance entre les métropoles régionales, ainsi que périurbains, et d’autre
part des chargeurs de fret longue distance et local, le tout à l’horizon 2020.
Cinq familles de scénarios ont été conçues et comparées au regard de leurs
effets sur les différentes catégories de trafic, de leur efficacité économique,
des impacts environnementaux et territoriaux. Deux scénarios portaient sur
l’aménagement plus ou moins lourd de la ligne existante, les trois autres
étaient basés sur la création d’une ligne nouvelle à grande vitesse sur une
partie ou sur la totalité de l’axe.
Le bilan d’analyse des scénarios au regard des
investissements nécessaires a montré le gain de service plus élevé apporté par
l’introduction d’une ligne nouvelle de Bordeaux à Toulouse ou de Bordeaux à
Toulouse et Narbonne. De plus, l’analyse des contraintes liées à
l’environnement et à l’insertion dans le cadre de vie montrait la faisabilité du
projet. Aussi, la création d’une ligne nouvelle selon l’un de ces deux
scénarios permet de disposer d’une offre suffisamment attractive en terme de
temps de parcours et de fréquence des dessertes, pour obtenir une véritable
massification des transports.
En conclusion de cette étude, la pertinence de
la réalisation d’une ligne à grande vitesse entre Bordeaux et Toulouse, comme
première étape de l’aménagement complet de l’axe de Bordeaux à Toulouse et
Narbonne a été validée, les aménagements du nœud ferroviaire de Toulouse et au
sud de Bordeaux constituant les compléments nécessaires pour libérer de la
capacité pour les deux lignes : nouvelle et existante.
Au moment où les études sont engagées pour la
préparation de l’enquête d’utilité publique de la ligne à grande vitesse de
Bordeaux à Toulouse, l’engagement d’une concertation ou d’un débat public pour
le prolongement de Toulouse à Narbonne est un sujet d’actualité qui doit être
considéré dans le cadre global qui est le sien : les lignes à grande vitesse
entre Bordeaux, Montpellier et Barcelone.
--------------------------------------------
Sources iconographiques : P. Castan ; Commission européenne